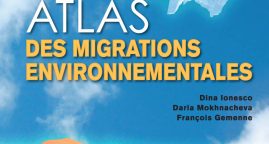Les faiseurs de paix
«Le Temps» publie les portraits de «faiseurs de paix» ayant participé le 21 septembre aux Geneva Peace Talks.
Ils œuvrent, chacun à leur manière, pour la paix dans le monde et se retrouvent à Genève pour les «Geneva Peace Talks» qui ont lieu depuis 2013 à l’initiative des Nations unies, de la Geneva Peacebuilding Platform et d’Interpeace
Hassan Ismail, l’intelligence pacificatrice
Avec sa famille, enfant, il a été constamment déplacé en raison de disputes claniques. Aujourd’hui, fort d’une éducation impressionnante, il négocie avec les shebab et s’active à pacifier la région de Mandera, en proie à de violents conflits depuis des décennies
La conférence est co-organisée depuis 2013 par l’Office des Nations unies à Genève, la Geneva Peacebuilding Platform et Interpeace.
Dans le langage bureaucratique onusien, on les appelle des «IDP», des personnes déplacées internes. Hassan Ismail a vécu dans sa chair les tribulations de ces gens malmenés par les conflits. Lorsqu’il avait 4 ans, sa famille appartenant au clan des Garre et installée dans le comté de Mandera coincé entre la Somalie, le sud de l’Ethiopie et le Kenya, a été chassée par un autre clan vers la ville d’El Wak. En tant qu’adolescent, il vécut un nouvel épisode tout aussi traumatisant, voyant deux de ses huit frères et sœurs ainsi que sa mère se faire battre devant lui. Son père perdit tout son cheptel de chameaux.
Après plusieurs déplacements, la famille finit par s’installer dans la ville d’Arabia, dans cette même portion de territoire kényan peuplée de quelque 1,1 million d’habitants et principalement de quatre clans d’origine somalienne, les Garre, les Murulle, les Dedodia et les Corner Tribes. Jeudi, il est venu au Palais des Nations parler de son expérience lors des Geneva Peace Talks. Son parcours de vie aurait pu le mener à commettre des actes de vengeance. Il l’a au contraire converti en faiseur de paix.
Forte sécheresse
Hassan Ismail, 46 ans, petite moustache et barbe discrète, s’est battu dès son plus jeune âge pour poursuivre son éducation scolaire, vendant tantôt des fruits tantôt des cigarettes dans la rue pour se payer l’école. «J’ai appris à survivre. Et j’ai pu compléter le lycée avant de suivre une formation d’enseignant de physique et de chimie.» Il pratique son métier pendant dix ans. Puis il se porte volontaire à la Croix-Rouge kényane avant de s’y engager à plein temps. Une forte sécheresse ravage la région.
«Je me suis rendu dans la ville d’Arabia pour apporter de l’aide. J’y ai rencontré le leader de la milice clanique qui pilla et chassa ma famille. On a déjeuné ensemble. Je lui ai demandé s’il se souvenait d’un vieil homme, mon père. Il pensait que j’allais me venger. Je voulais simplement connaître ses motivations, pourquoi il avait agi ainsi envers ma famille. J’ai fini par lui donner une petite aide financière», raconte Hassan Ismail.
De nombreuses vies sauvées
Parlant le swahili, l’anglais, l’oromo, deux dialectes somaliens et un peu d’arabe, Hassan Ismail a fait de son enfance difficile un atout. Fils d’un musulman mort à la Mecque en plein hadj alors qu’il l’accompagnait, il a, en 2011, choisi d’aller travailler en Somalie frappée par une terrible famine. Mais des portions entières de territoires près de Hiiraan sont contrôlées par les islamistes shebab. Aucun accès humanitaire n’est possible. Les internationaux estiment urgent de déplacer ces gens menacés par la faim vers les villes de Mogadiscio ou de Dolow. «Je ne pouvais pas accepter une telle option, se souvient Hassan. Socialement, déplacer des gens est une catastrophe. Je l’ai vécu. On pousse les gens à tout quitter. C’est une manière de perpétuer une crise humanitaire. Pour moi, il fallait aider les gens là où ils habitent.»
Hassan Ismail négocie avec plusieurs shebab. Il obtient un accès limité. Mais à certaines conditions: pas d’agents du Programme alimentaire mondial, pas d’étrangers, pas d’Arabes. Seulement des Africains. Il pose ses conditions: choix de décider librement à qui va l’aide humanitaire. Il s’entend avec les shebab sur un autre point: pas de livraison de nourriture dont la date de consommation a expiré. De nombreuses vies sont ainsi sauvées.
Embrasser la complexité des êtres au-delà de l’uniforme
Fort d’un master en résolution de conflit, ce père de neuf enfants quitte l’humanitaire. En 2014, il se lance dans un vaste programme de consolidation de la paix dans la région de Mandera pour l’ONG Interpeace en coopération avec la Commission kényane de cohésion et d’intégration. Son approche, il la résume par une image: une pièce de monnaie à un côté pile, un côté face. Or il ne faut pas oublier la tranche qui relie les deux faces. Pour Hassan, résoudre des conflits, c’est embrasser la complexité des êtres au-delà de l’uniforme, de l’appartenance. Il y a, dit-il, davantage de points communs entre les êtres humains que de différences: «Dans tout conflit, il y a toujours des personnes-ressources capables de rétablir des ponts.»
Dans le Mandera, il recourt aux vieux sages (elders) de la communauté et aux milieux économiques. Il identifie les racines des conflits. Les clans se disputent depuis des décennies. Les frustrations s’accumulent. Le gros problème, c’est l’absence totale de confiance entre les forces de sécurité et la population locale. Un problème qui remonte à la guerre de sécession de 1963, où des factions voulaient rallier la Somalie. Hassan Ismail se met à table avec les forces de sécurité. «Ce fut très difficile au départ», admet-il. Mais les choses avancent.
Sanctions inefficaces
Arrivé à Genève mercredi, Hassan Ismail fait d’emblée de l’humour: «J’ai reçu un visa de la Suisse jusqu’à vendredi seulement. Ont-ils peur que je sois un réfugié?» ironise-t-il. Dans son refus du manichéisme, il émet quelques suggestions aux Occidentaux, notamment après les déclarations belliqueuses du président Donald Trump à l’ONU laissant entendre qu’il pourrait détruire totalement la Corée du Nord.
«Si j’étais l’Europe ou les Etats-Unis, j’arrêterais de livrer des armes à l’Afrique et au Moyen-Orient. Car pour toute livraison d’armes, ils recevront autant de réfugiés. Et je ne refuserais jamais le dialogue.» Quant à la pratique des sanctions, elles ne «sont pas une méthode efficace pour restaurer la paix. Elles ne touchent que les populations, non les dirigeants.»
Alvaro Pico Malaver, le général colombien qui a osé la paix
Il a passé une bonne partie de sa vie à combattre la guérilla des FARC. Mais lors des négociations secrètes qui ont duré plus de deux ans, le général Pico Malaver a joué un rôle clé pour mettre fin au conflit
Si quelqu’un, il y a quelques années, lui avait prédit qu’il serait aujourd’hui là où il est, Alvaro Pico Malaver (il n’était alors «que» colonel de police) lui aurait ri au nez. «J’aurais cru à une blague. A l’époque, toute idée de paix relevait de la pure utopie.» Il se souvient de ce jour où son supérieur l’avait appelé pour lui proposer de faire partie de la délégation gouvernementale. C’est presque comme s’il n’en revenait toujours pas lui-même: «C’était invraisemblable. Ça semblait arriver de nulle part.» Pendant plus de deux ans, Pico Malaver (qui a gagné entre-temps les galons jusqu’à devenir brigadier général) a pourtant fait partie de ceux qui ont ardemment, et secrètement, négocié la paix avec leurs ennemis, la guérilla des FARC, l’une des plus anciennes et des plus aguerries du monde. Négocié, puis obtenu la paix.
Lorsqu’il est né, il y a cinquante-deux ans, les Forces armées de libération de Colombie avaient été créées un an plus tôt. C’est peu dire que Pico Malaver, qui a intégré comme jeune homme la police nationale colombienne, a consacré jusqu’ici l’essentiel de sa vie à combattre ces insurgés. Certes, la police, ce n’est pas l’armée. Mais encore aujourd’hui, ses unités dépendent du Ministère de la défense. Elles ont multiplié les assauts et les batailles, disposent d’hélicoptères, ont fait pendant un demi-siècle partie intégrante des forces nationales de contre-insurrection. Alvaro Pico Malaver a été, entre autres, directeur d’Interpol Colombie et a beaucoup travaillé dans le domaine des enquêtes criminelles. «Mais j’étais aussi dans diverses zones de combats intenses, se contente-t-il de rappeler. Nous sommes tous en étroite relation avec ce conflit.»
8 376 463 victimes
Ce jeudi, devant les autres participants des «Geneva Peace Talks» qui, comme lui, connaissent de près la guerre et la paix, le général devrait évoquer ces moments où il remettait symboliquement un drapeau colombien aux familles de ses collègues tués. Il décrira les souffrances de ceux qui ont perdu les bras ou les jambes, ont été enlevés par la guérilla, porteront pour toujours les blessures physiques ou mentales de ce «conflit tellement atroce». Puis il résumera tout cela d’un seul chiffre, ahurissant: 8 376 463 victimes à un titre ou un autre, selon le décompte officiel. Grosso modo comparable à la population totale de la Suisse.
Pendant deux ans, comme lui, sa famille et les rares amis proches qu’il avait mis dans la confidence n’en revenaient pas lorsqu’il prenait, une fois de plus, un avion en direction de La Havane, où se tenaient les négociations. Cinq généraux d’un côté, autant de cadres de la guérilla de l’autre: cette «sous-commission technique» devait trouver le moyen de dessiner les modalités de la fin du conflit armé. Ni plus ni moins.
Etablir la confiance
Le climat des discussions? «Tendu, très tendu.» La première condition d’un éventuel succès, auquel tout le monde avait encore grandement peine à croire? «Nous nous sommes mis d’accord pour poser des barrières qu’il ne fallait pas dépasser. Pas question d’aborder nos différences politiques ou idéologiques. Nous n’étions pas là pour essayer de nous convaincre mutuellement, ç’aurait été impossible.» Les morts, les blessés, les horreurs pèsent lourdement de part et d’autre. Mais ils n’empêchent pas de progresser sur des documents extrêmement techniques; un texte accompagné d’une trentaine de protocoles additionnels, qui visent à bétonner chaque détail de l’accord, aussi infime soit-il.
«Les négociations ont été ardues, mais elles se sont toujours déroulées dans le respect», insiste le général. Aucun lien d’amitié n’a pu s’établir par-dessus les tables des discussions. Mais la confiance a commencé à se tisser au fil de ces centaines d’heures de face-à-face.
Unité spéciale pour la paix
Pico Malaver ne le dira pas de cette manière, il craint trop de faire preuve d’«arrogance». Mais en parallèle à ces discussions, le général lance une initiative qui se révélera déterminante. Alors que l’accord éventuel est encore très loin, et qu’il n’est pas du tout question pour les FARC de se désarmer, il commence à créer une unité spéciale de la police pour l’unification de la paix, l’Unipep: quelque 3000 policiers, soigneusement choisis, dont la tâche consistera principalement à garantir la sécurité du processus.
S’il s’agit de «relocaliser» les ex-guérilleros dans des zones spécifiques (les FARC n’aiment pas le terme «regrouper»), s’il s’agit pour eux de «laisser les armes» (ils refusent le terme «déposer»), il faudra bien quelqu’un pour assurer leur protection. «Le moindre attentat ou une attaque auraient risqué de tout mettre par terre», souligne-t-il.
Les FARC sont devenus des citoyens comme les autres. Et c’est à nous, police nationale, de protéger leurs droits et leur liberté
L’accord de paix est conclu le 23 avril 2016. Accompagnés des policiers (armés) de l’Unipep, quelque 8000 membres des FARC commencent leur déplacement pour s’installer dans les 27 zones transitoires délimitées par les négociateurs, puis ce sont plus de 9000 armes qui seront livrées aux Nations unies. Pas un seul incident n’a été signalé. «Encore aujourd’hui, c’est mon unité qui assure la protection de certains dirigeants des FARC», note Pico Malaver.
Un incroyable gage de confiance, dont les fils remontent jusqu’à ces interminables discussions de La Havane. Le plus difficile, soit l’intégration complète des ex-guérilleros, est sans doute encore à venir. Mais aujourd’hui, Alvaro Pico Malaver n’en démord pas: «Les FARC sont devenus des citoyens comme les autres. Et c’est à nous, police nationale, de protéger leurs droits et leur liberté.»
Hyung Joon-won, du Beethoven pour Kim Jong-un
Le violoniste sud-coréen va inviter les dirigeants de six pays à écouter Beethoven à Panmunjom, en terrain miné, à la frontière entre les deux Corées, pour établir un dialogue entre Kim Jong-un et Donald Trump. Avant qu’il ne soit trop tard.
Jeudi, au Palais des Nations à Genève, Hyung Joon-won, violoniste sud-coréen de 41 ans, va interpeller six chefs d’Etat. Il va leur dire: «Qu’est-ce qui est le plus difficile, tuer des gens ou organiser un concert? La réponse est logique.» Puis les invitations vont partir: une pour le président sud-coréen, Moon Jae-in, une pour le leader nord-coréen, Kim Jong-un, une pour le premier ministre japonais, Shinzo Abe, une pour le président russe, Vladimir Poutine, une pour le président chinois, Xi Jinping, une enfin pour le président des Etats-Unis, Donald Trump. Rendez-vous à Panmunjom, point de contact entre le Nord et le Sud dans la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne en deux. On jouera du Beethoven (la 9e Symphonie) et l’Arirang, morceau le plus célèbre du folklore coréen. Cela doit se faire avant la fin de l’année. Avant que la guerre n’éclate.
Au téléphone depuis Paris, où il peaufine son discours, Hyung Joon-won insiste: «Beaucoup de gens pensent que je plaisante, que je rêve. Mais je vais le faire. Si un seul répond présent, les cinq autres diront oui.» Marié, père d’une fille de 9 ans, le violoniste formé aux Etats-Unis habite Séoul, la capitale sud-coréenne, à portée de canon des lignes nord-coréennes. Il doit pourtant bien reconnaître que la situation n’a jamais été aussi tendue depuis la signature de l’armistice en 1953. D’habitude, les 10 millions de Séouliens restent indifférents aux salves rhétoriques et essais militaires en tous genres de leurs voisins du Nord. Là, on sent bien que c’est «plus sérieux».
Premier projet torpillé
Son idée de concert remonte à quelques années déjà. En 2009, il entend parler de Daniel Barenboim et de son orchestre composé de jeunes musiciens israéliens et palestiniens. Quand deux peuples ne se parlent plus, la musique restaure le dialogue. Voilà plus d’un demi-siècle que Nord-Coréens et Sud-Coréens n’ont plus de contacts. Un concert composé pour moitié de musiciens du Nord et pour moitié du Sud créerait l’événement. Cette force de la musique, comme instrument de paix, il l’avait déjà observé lorsqu’il fut invité à jouer au World Economic Forum pour célébrer la réunification allemande.
Ce premier projet – un orchestre intercoréen – a failli voir le jour à l’été 2011. La partie nord-coréenne avait donné son feu vert pour un concert à Pyongyang. Hyung Joon-won avait son visa nord-coréen en poche. Au même moment, toutefois, un navire sud-coréen fut coulé par un tir de torpille attribué à l’armée nord-coréenne. «Je n’ai même pas essayé d’y aller. Les gens en Corée du Sud n’auraient pas apprécié.» Quand des tentatives d’échanges se dessinent, sur le plan économique ou culturel, le soupçon de traîtrise plane. A l’époque, c’est le chef d’orchestre suisse Charles Dutoit qui se rendit finalement à Pyongyang. Le Nord a un conservatoire et un orchestre philharmonique de qualité. Mais ce fut sans les musiciens du Sud.
Beethoven en terrain miné
Depuis, essai nucléaire après essai nucléaire (c’était le sixième en début du mois), la situation n’a fait qu’empirer. Les autorités sud-coréennes ont tenté de dissuader Hyung Joon-won: pourquoi ne pas attendre des temps meilleurs? «C’est maintenant que se joue la paix, rétorque le violoniste-activiste. Avant le pire, essayons de nous parler avec la musique. C’est le seul langage universel. Il faut montrer qu’un espoir demeure.» Cette détermination est celle d’un Coréen de famille séparée, comme on dit au Sud. Alors que de plus en plus de Sud-cCoréens envisagent l’avenir sans réunification de leur pays, ceux qui ont des liens familiaux au Nord n’abandonnent pas. L’arrière-grand-mère paternelle de Hyung Joon-won est enterrée au Nord. Il veut pouvoir un jour se rendre sur sa tombe.
Son projet de concert intercoréen à Pyongyang s’étant évanoui, Hyung Joon-won a une autre idée: pourquoi ne pas jouer dans la DMZ, au cœur de la zone la plus militarisée de la planète, mais en zone neutre, cette fois-ci avec tous les acteurs de la crise coréenne? Les six pays dont il a invité les chefs d’Etat sont ceux qui ont participé aux négociations sur le nucléaire nord-coréen, suspendues depuis huit ans. Sans un accord entre eux, il ne peut y avoir de paix dans la péninsule. L’orchestre sera donc composé de musiciens de ces six pays, avec un public venu de ces six pays. Il faudra l’accord de l’ONU, qui contrôle Panmunjom, ainsi que celui de la Suède et de la Suisse, derniers Etats membres de la Commission de supervision des nations neutres (CSNN) de l’armistice.
Kim Jong-un doit comprendre
Et il faut également l’accord de Kim Jong-un – plutôt amateur de pop. «Avant de dire qu’il est fou, il faut essayer de lui parler. On ne l’a jamais fait. Il doit comprendre pourquoi le monde entier s’inquiète de ce qu’il fait», explique Hyung Joon-won. Après son discours, jeudi, il va envoyer ses courriers aux chefs d’Etat. Il espère remettre en main propre au représentant nord-coréen auprès de l’ONU à Genève sa lettre d’invitation à Kim Jong-un. A Séoul, un tel contact est interdit.
Christian Picciolini, néonazi repenti
Leader d’un groupe de skinheads à l’âge de 16 ans, l’homme a quitté le milieu des suprémacistes blancs. Il tente aujourd’hui d’aider ceux qui veulent échapper à des groupes extrémistes
Il a tout fait. Il a tabassé des Noirs, vendu des drapeaux de Confédérés dans son échoppe de musique, participé à des réunions du Ku Klux Klan; il s’est tatoué «white power» et des svastikas sur le corps et a fait le salut hitlérien devant un camp de concentration. Christian Picciolini raconte son parcours avec une sincérité déroutante. Patient, il n’élude aucune question gênante et replonge avec nous dans les heures les plus sombres de son passé.
Il le fait d’autant plus volontiers qu’il est désormais un «ex». Un ex-néonazi raciste, violent, colérique et haineux. Repenti, Christian Picciolini gère aujourd’hui Life After Hate, une organisation fondée en 2010 qui cherche à venir en aide à ceux qui veulent quitter des mouvements extrémistes.
Chasse dans un McDonald
Mais revenons aux racines du mal. Tout a commencé par un simple joint, à 14 ans, à Chicago. C’était en 1987. «Je fumais, de la marijuana. Un type est venu, m’a enlevé le joint de la bouche en me disant que c’était la manière dont les juifs et les capitalistes nous tenaient dociles. Il m’a recruté comme ça.»
Cet homme, c’était Clark Martell, le premier néonazi skinhead des Etats-Unis, leader des Chicago Area Skinheads (CASH). Il a su lui donner un cadre, une «famille». Avec la musique comme outil de propagande. «Pour la première fois, je me sentais puissant.» Christian Picciolini ne vient pas d’un milieu raciste. «Je n’avais aucune affinité avec l’idéologie d’extrême droite. Mes parents sont des immigrés italiens arrivés dans les années 1960. Ils ont dû travailler très dur, 24h/24 et 7 jours sur 7. J’étais en colère. J’avais le sentiment d’être abandonné. M’accorder de l’importance a suffi pour que je bascule.»
Très vite, il adopte tous les codes des skinheads. Quand Clark Martell est emprisonné pour avoir, avec six autres membres du clan, agressé une femme skinhead vue avec un Noir et peint un svastika avec son sang sur un mur de sa maison, il devient chef. Leader d’une des bandes d’extrême droite les plus violentes à 16 ans!
«J’étais ambitieux, grande gueule, rempli de haine. Les autres me voyaient naturellement comme leader. J’aimais faire peur.» Il fonde des groupes de musique, dont Final Solution, et utilise à son tour la musique pour recruter. Il ne cache pas avoir été très violent.
Comme ce jour où il chasse des Noirs d’un McDonald, les poursuit à l’extérieur, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, paniqué, sorte son pistolet. «Nous l’avons attrapé, et frappé, frappé. Le visage en sang, il a réussi à ouvrir les yeux et à me regarder, terrifié. A ce moment-là, j’ai senti une sorte de connexion entre nous.»
Des skinheads à IBM
C’était l’une de ses premières phases de doutes. La naissance de son enfant, à 19 ans, lui fait comprendre qu’il est capable de ressentir autre chose que de la haine. Pressé par sa femme de quitter les skinheads, Christian Picciolini mettra plus de cinq ans pour y arriver.
«Je me suis d’abord un peu mis en retrait, en me concentrant sur la musique «white power» que je vendais et produisais moi-même. J’ai par la suite, pour gagner ma vie, dû me diversifier dans la vente, avec du hip-hop notamment. Des Noirs, des juifs, des homosexuels sont venus dans mon échoppe, malgré ma réputation. Cette empathie m’a impressionné.»
Quand il coupe définitivement les ponts avec les skinheads huit ans après y être entré, c’est déjà trop tard. Sa femme est partie avec leurs deux enfants. Christian Picciolini se retrouve seul. Il a des pensées suicidaires. Une amie réussit à le faire engager chez IBM, alors qu’il n’y croyait pas.
Un de ses premiers mandats a été de se rendre dans le collège duquel il a été renvoyé deux fois. Il croise un gardien noir, le suit. Ce dernier le reconnaît, fait un pas en arrière, de peur: il se souvient de l’élève qui l’avait frappé alors qu’il tentait de s’interposer dans une rixe. Mais l’ancien néonazi est là pour s’excuser. Le gardien le prend dans ses bras. «C’est grâce à lui que j’ai écrit un livre et que je donne des conférences. Il m’avait fait promettre de raconter mon histoire.»
La haine comme un cancer
Il a fondé Life After Hate avec d’autres néonazis repentis, pour venir en aide aux victimes de radicalisation de tous types, djihadistes compris. «J’essaie d’abord de comprendre ce qui les a poussés à adhérer à un groupe violent. J’organise ensuite des rencontres. Un antisémite avec un survivant de l’Holocauste, par exemple. Souvent, ces gens sont dévorés par la haine de l’intérieur, comme un cancer, sans même comprendre pourquoi ils ressentent une telle haine.»
Il ne nie pas aussi agir ainsi pour tenter de réparer le passé. «J’ai répandu et planté tellement de graines de haine… Des gens que j’ai recrutés sont en prison à cause de moi. Pire, le gars qui a tué six personnes dans un temple sikh du Wisconsin en 2012 écoutait ma musique.»
Trump, porte-parole des suprémacistes blancs
Avoir quitté l’extrême droite lui vaut des menaces de mort. «On me traite d’agent du FBI, d’espion à la solde d’Israël ou de sympathisant de l’Etat islamique…» Il est sans concession à l’égard de Donald Trump, «le président idéal pour les suprémacistes blancs, à travers ce qu’il dit et ce qu’il ne dit pas».
«A mon époque déjà, les néonazis avaient comme stratégie la «normalisation» – on se laissait pousser les cheveux, on tentait d’infiltrer tous les milieux – pour mieux recruter et prendre le pouvoir. Trump offre une plateforme d’expression parfaite pour ces milieux.»
Christian Picciolini a vécu un drame personnel, en 2004, qui aurait pu le faire à nouveau basculer. Son frère de 20 ans a été tué par un Noir alors qu’il se rendait à une fête. «Je n’étais pas en colère: le meurtrier était animé par exactement la même haine qui m’habitait des années avant.»
Ses tatouages, il ne les a pas enlevés. Mais il a recouvert les plus ignobles. On n’efface pas si facilement les traces de son passé.
Sur le même sujet
Commission de l’océan Indien : accord de partenariat avec l’Ordre de Malte
04/07/2017. Le Secrétaire général du COI a signé au siège de l’Ordre Souverain de Malte, l’Accord-Cadre de Partenariat qui lie désormais les deux institutions et organise leur coopération.
Atlas des migrations environnementales
mai 2017. L’objectif de ce projet est d’améliorer la compréhension des liens complexes entre la migration, l’environnement et le changement climatique
Le problème des convois humanitaires
03/10/2016. Ces convois sont-ils un symptôme surfait d’un système humanitaire politisé qui n’a pas su sauver le peuple syrien ?